Ce fut le premier fromage reconnu par les autorités administratives: on a retrouvé un arrêt du
Parlement de Toulouse de 1666 qui punissait les faux marchands de Roquefort. Déjà la volonté de protéger ce produit, devenu véritable économie pour son terroir, se faisait sentir et a été par la suite consolidée par l’obtention du label « Appellation d’Origine » en 1925.
On dit aujourd’hui que c’était le fromage favori de Charlemagne, et on s’aventure même à prêter aux romains une affection toute particulière pour son ancêtre. Quoi qu’il en soit de ces anecdotes, tout suggère que c’est un très vieux fromage, depuis longtemps apprécié et surtout reconnu.
Le Roquefort fait partie de la famille des pâtes persillées : fabriqué à partir de lait de brebis de la race Lacaune précisément, cru et entier obligatoirement, le fromage pèse entre 2,5 et 3kg. Il siège sur un large territoire : les départements de l’Aveyron, du Tarn, de la Lozère, de l’Hérault, de l’Aude et du Gard fournissent le lait nécessaire à sa production très importante en volume.
Mais la particularité du Roquefort est plus que défendue par cette zone d’appellation : chacun doit, en effet, passer quatorze jours à nu dans les caves du massif du Combalou, qui domine la petite ville de Roquefort-sur-Soulzon, berceau du mystérieux fromage. Ce massif n’est pas comme les autres : il est aéré, suite à un éboulement, par des conduits naturels qu’on appelle fleurines. Cela permet d’assurer une hygrométrie et une température constante, nécessaire à l’affinage, et qui donne toute sa typicité au produit final. On envoie ensuite les fromages terminer leur affinage pour quatre-vingt dix jours, mais attention, sur le territoire de la commune uniquement.

Le Roquefort doit sa pâte persillée à l’emploi d’un ensemencement en Penicillum Roqueforti lors de sa fabrication. Venant en réalité de la moisissure du pain de seigle, c’est lui qui forme les « cavernes » bleues au sein du fromage. Après avoir fait maturer le lait, l’avoir emprésuré, on tranche le caillé en grains pas plus gros qu’une phalange, pour ensuite le « coiffer ». C’est-à-dire que lors du brassage, on va « enrober » le grain de lactosérum de manière à ce que, lors du moulage, les grains ne forment pas tout à fait une masse compacte. Pourquoi ? Tout simplement pour laisser passer l’air nécessaire au développement du Penicillum, à l’image des fameuses fleurines du Combalou au sein même du fromage. Car non, nous n’injectons pas la moisissure au sein du fromage, comme on serait tentés de le penser en premier lieu. On le pique sous dix jours, pour lui faire ses propres conduits d’aérations.
Pour son conditionnement, le Roquefort était auparavant emballé dans des feuilles d’étain, mais ses propriétés dangereuses ont encouragé un changement au profit de l’aluminium. Des femmes, qu’on appelait les cabanières, emballaient les Roquefort, selon la technique du « plombage », après avoir salé en surface le fromage. Un métier ancien, transmis de génération en génération, qui a aussi contribué à préserver ce produit unique jusqu’à aujourd’hui.

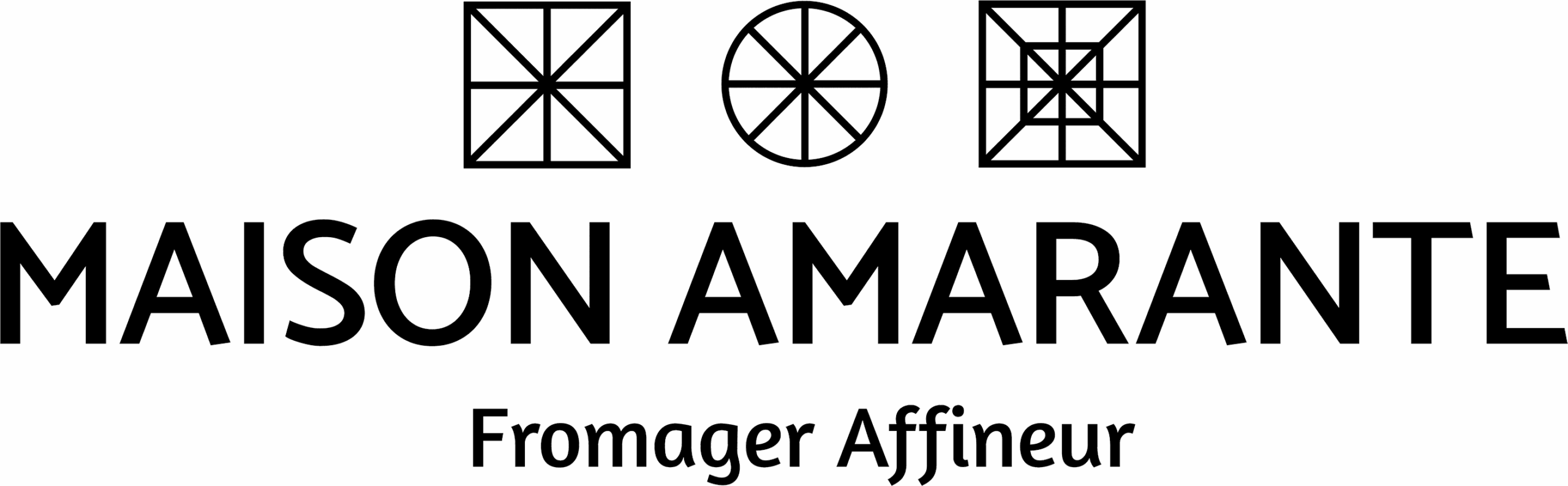

Comments are closed